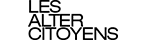Le remix “Je ne savais pas que je savais” réalisé par Alexandre Gingras en collaboration avec Alain Deneault fait l’objet d’un article dans la revue liberté, Éditions printemps 2015.
Le remix “Je ne savais pas que je savais” réalisé par Alexandre Gingras en collaboration avec Alain Deneault fait l’objet d’un article dans la revue liberté, Éditions printemps 2015.
Voici l’intégral de l’article, disponible au http://revueliberte.ca/content/je-ne-savais-pas-que-je-savais
Quand le situationniste René Viénet recomposait la bande-son d’un mauvais film d’arts martiaux, alors rebaptisé La dialectique peut-elle casser des briques?, pour placer dans la bouche des personnages les mots d’ordre de la gauche radicale, il tordait le sens de la production initiale au point de la rendre méconnaissable. De même, quand Guy Debord insérait, en 1973, dans sa version cinématographique de La société du spectacle une critique d’une séquence prise hors contexte de Pour qui sonne le glas? de Sam Wood, dans le but d’exemplifier le principe d’intransigeance en politique, il «détournait» le sens du film afin de lui donner de la fraîcheur, sinon de lui insuffler une signification radicalement nouvelle. Le détournement si prisé consistait alors, écrivait Debord, à faire violence au sens attesté des concepts, symboles et syntagmes figés de l’heure, pour que, plaqués dans un nouvel agencement, ils résonnent autrement. Il s’agissait, selon la lettre, de transférer dans un nouvel environnement «l’ancien noyau de vérité» d’une référence, sans y chercher la garantie d’un sens dont elle était à l’origine porteuse.
Aujourd’hui, Alexandre Gingras, auteur de remix, cet art de l’assemblage et du remontage d’images captées dans le domaine public, travaille dans le même esprit : tirer de références détournées le suc qui leur fera dire quelque chose de prégnant du point de vue politique. Or, c’est moins pour falsifier des références culturelles que l’intéressé les pille que pour révéler pratiquement tel quel le message dont elles sont porteuses. Il ne leur donne pas un sens différent, mais permet que, du nouveau montage, émerge le sens même, soudain rendu perceptible. Du coup, nous nous trouvons incités à remettre en cause l’idée convenue et commune que les médias de l’industrie culturelle nous mentent. Il appert au contraire qu’ils narrent souvent le monde sans fard, mais sur un mode hypnotique et stérile. Chez Gingras, message isn’t the medium anymore; il s’agit de détourner cette fois la phrase célèbre de Marshall McLuhan: le message perd son média d’origine. Soustraits à l’agencement routinier qui suscite l’écoute de type somnambulique – la déclaration politicienne du soir, la série télévisée d’après-souper, le cinéma de divertissement, l’affiche publicitaire –, le discours et l’image acquièrent du relief et choquent.
Cela est particulièrement clair dans le plus récent des courts-métrages de Gingras sur la présence des paradis fiscaux dans la culture grand public, illustrant, par force détournements, quelques observations que j’avais faites dans mon livre Offshore. Le point de départ de ce travail se situe aussi loin que chez Aristote. Dans la Poétique, le philosophe attique souligne que la fonction du poète tragique «est de dire non pas ce qui a réellement eu lieu, mais ce à quoi on peut s’attendre, ce qui peut se produire conformément à la vraisemblance ou à la nécessité». Cette théorie fameuse permet aujourd’hui d’expliquer pourquoi les réalisateurs d’un cinéma à grande diffusion, tout comme un ensemble de bédéistes européens ou d’auteurs de romans noirs, ont très rapidement, beaucoup plus prestement que les journalistes, les universitaires, les militants ou les politiques, intégré dans leurs travaux des références aux paradis fiscaux et autres législations de complaisance.
Pour présenter de manière crédible un grand baron de la drogue, un élu gravement corrompu, un trafiquant d’armes ou une banque finançant des dictatures, notre époque a rendu nécessaire de doter tous ces personnages de comptes à numéros et de les montrer, aux fins de la vraisemblance, conscients de l’ingénierie financière opaque et anomique que permettent les paradis fiscaux. Dès lors la Suisse et les îles Caïmans, principalement, sont apparues dans les intrigues, avant que de nouvelles narrations ne se déroulent dans le décor des Bahamas, du Luxembourg ou du Liechtenstein. Qui n’en a pas noté la présence dans les différentes productions du Parrain ou de James Bond? Pour un spectateur averti, il n’est pas seulement remarquable que la question des paradis fiscaux soit apparue si vite et si crûment dans les œuvres, mais que leur évocation ait aussi rapidement porté sur une multitude de cas de figure, allant de l’inscription domiciliaire de grands détenteurs de fortunes à la création de sociétés-écrans par les entreprises à l’origine d’opérations criminelles, en passant par la gestion sur place des services secrets, du transport maritime, du pari sportif, des délits d’initiés, de l’épargne mafieuse, de la prostitution internationale, de la vente d’armes, de la fusion d’entreprises, de la corruption politique, du blanchiment d’argent et bien sûr du trafic de la drogue.
Mais c’est pour le considérer à l’envers qu’il est pertinent de faire état du problème… Par souci de vraisemblance, l’industrie culturelle associe en effet étroitement certains personnages puissants aux paradis fiscaux parce que le public a déjà une conscience certaine, quoiqu’intuitive, du phénomène offshore. Le public sait ce qu’il en est des paradis fiscaux, il doit nécessairement savoir, puisque c’est pour éviter de brusquer ses considérations standards sur les réalités du monde (le «vraisemblable idéologique», aurait dit Gérard Genette) qu’on nous sert continuellement des références aux paradis fiscaux.
Politique et cinéma
On peut classer en différentes catégories les œuvres détournées dans le remix de Gingras. Parmi les productions grand public, on en retrouve d’abord un certain nombre qui s’en tiennent à des évocations furtives des paradis fiscaux. Wall Street d’Oliver Stone met en lien les paradis fiscaux et la question des délits d’initié; le roman The Runaway Jury de John Grisham, adapté au cinéma par Gary Fleder en 2003, traite pour sa part du trafic d’influence conduit outre-mer, tandis que Millenium, le roman à succès de Stieg Larsson également porté au grand écran, éclaboussera un criminel à cravate ayant dissimulé sa fortune aux îles Caïmans.
Certaines de ces évocations peuvent se révéler cruciales dans le déroulement d’un récit: Blood Diamond d’Edward Zwick, par exemple, fait tourner son intrigue autour d’un affairiste qui prétend mener la lutte aux trafics de diamants sales alors qu’il l’organise lui-même «à travers une série de holdings et de comptes bancaires offshore». D’autres références peuvent être tout à fait inattendues, comme The Dark Knight de Christopher Nolan, où Batman poursuit à Hong Kong un banquier mafieux qui se trouve là hors de portée des autorités traditionnelles. D’autres productions « grand public » comme le roman The Firm de John Grisham ou le film The International de Tom Tykwer réservent une place résolument centrale aux paradis fiscaux, dans la mesure où y recourent des politiciens corrompus, trafiquants d’armes et leurs avocats véreux.
Dans toutes ces histoires, les paradis fiscaux préexistent, on ne les crée pas comme on invente les intrigues qui s’y déroulent. Tout au plus y va-t-on parfois de scènes d’exposition où on expliquera, comme dans Anthony Zimmer de Jérôme Salle, la technique du faux procès pour blanchir des capitaux offshore. Dans tous les cas, les paradis fiscaux ne visent jamais des prises de conscience politiques particulières.
Les films de fiction à tonalité critique, de leur côté, pratiquent volontiers la dénonciation. Des passages entiers constituent manifestement des exercices pédagogiques visant à outiller conceptuellement les spectateurs face au problème historique que représentent les législations de complaisance. Les réalisateurs Gustave Kervern et Benoît Delépine, dans Louise Michel, montrent à l’île de Jersey des employés licenciés qui se butent à des boîtes aux lettres lorsqu’ils cherchent à en découdre avec leurs anciens patrons. Même chose dans Mille milliards de dollars d’Henri Verneuil, un long métrage des années 1980 dans lequel un grand patron s’étend sur les techniques du prix de transfert que son groupe met en application en Suisse, de façon à bloquer le plus de capitaux possible dans la filiale de ce pays où le taux d’imposition est faible.
D’autres réalisateurs feront par un clin d’œil complice le même constat: Woody Allen dans Blue Jasmine ou Jean-Luc Godard à la fin de Prénom Carmen montrent furtivement les lieux où les gens d’affaires pratiquent leurs sombres combines, quand ce n’est pas, au Québec, les romanciers Serge Lamothe (L’ange au berceau) ou Jean-Jacques Pelletier (L’argent du monde) qui situent outre-mer d’autres affaires ténébreuses.
L’importance politique du cinéma
L’enjeu a peu à voir avec les intentions divertissantes ou critiques, alléguées, de ces productions. L’esthétique joue surtout ici, du point de vue de la pensée et de l’action politiques, un rôle de révélateur. On ne saurait prétendre sérieusement au trafic de la drogue sans user de ces États libertariens que sont devenus les paradis fiscaux, très souvent avec la bénédiction des États traditionnels qui ont beau jeu de se faire passer pour démocraties. Cela se sait, le cinéma en témoigne. Drug Wars de Brian Gibson le fait explicitement, tout comme la série télévisée The Wire. Dans les deux cas, on voit clairement des narcotrafiquants quitter la rue pour devenir les nouveaux caïds et passer ainsi des liasses de billets aux comptes à numéros créés dans les Caraïbes. En cela, les productions d’Hollywood semblent davantage épouser que créer un mouvement de conscience commune des réalités offshore.
Le public sait, donc, mais principalement sur un registre qui relève strictement du divertissement. En dehors de ce champ de référence, il ne sait pas qu’il sait. Les productions esthétiques révèlent cet état de conscience plus qu’elles ne le produisent. Mais le révélant, elles rendent possible l’après-coup de savoir qu’on sait. Alexandre Gingras a donc recueilli une multitude de fragments cinématographiques évoquant les affaires offshore pour les lui rappeler, mais tout autrement. C’est surtout son propre état de connaissance que son remix jette au visage du spectateur. Par la multiplication des occurrences esthétiques sur les perversions offshore, la conscience se saisit elle-même et se rend compte de ce qu’elle savait déjà. L’enjeu est d’autant plus crucial en ce qui concerne les paradis fiscaux qu’on ne sait pas témoigner empiriquement de ce qui s’y trame; le secret administratif et bancaire nous en empêche. L’esthétique donne ainsi à voir ce que l’on n’arrive pas à voir. Le passage à la politique est ensuite l’affaire de mobilisations publiques qui dépassent la seule responsabilité des artistes.
Pour voir ou revoir notre film: https://vimeo.com/119922469